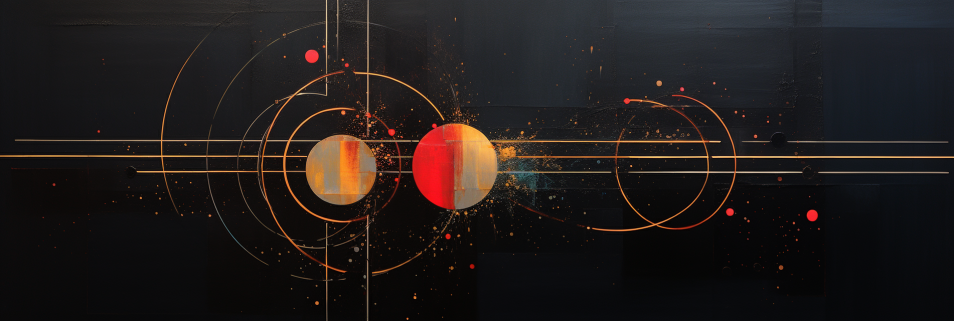Shanghai, début des années 90 : l’argent circule plus vite que les promesses, et chaque néon allumé ressemble à un pari. Avec Blossoms Shanghai, Wong Kar-wai transforme l’ascension d’A Bao en fresque romanesque, sensuelle et électrique, où l’amour et le pouvoir parlent la même langue.
🗃️ Fiche du film – Blossoms Shanghai
Cliquez pour voir la fiche
- Réalisation / production : Wong Kar-wai
- Scénario : Qin Wen (adaptation)
- Casting principal : Hu Ge (A Bao / “Mr. Bao”), Ma Yili (Ling Zi), Tang Yan (Miss Wang), Xin Zhilei (Li Li), You Benchang (Oncle Ye)
- Format : 30 épisodes (environ 45–50 min chacun)
- Cadre : Shanghai, début des années 1990, au cœur de l’ouverture économique et de la fièvre boursière
- Langues : shanghaïen (très présent) + mandarin
- Diffusion : d’abord en Chine (TV + streaming), puis déploiement international progressif
- Budget : pas de chiffre officiel unique. Ce qui circule le plus, c’est un investissement massif dans les décors, avec notamment un décor de rue recréé à grande échelle (souvent évoqué autour de 500 millions de yuans pour la construction de cet environnement), et une fabrication étalée sur plusieurs années.
On connaît Wong Kar-wai pour ses amours en apnée, ses silences qui parlent plus fort que les dialogues, sa façon de filmer la distance entre deux personnes comme un continent. Ici, il passe au format série sans renier son ADN : le temps s’étire, les regards s’attardent, la musique sert de mémoire, et les couloirs d’hôtels deviennent des artères émotionnelles. Mais Blossoms Shanghai n’est pas un musée de “trucs wongiens”. C’est une œuvre qui s’autorise autre chose : la densité romanesque, l’énergie de la réussite, la brutalité des rapports de force, le goût de la stratégie. C’est Wong, oui — mais Wong qui s’amuse avec un terrain immense.

Au centre : A Bao, interprété par Hu Ge avec une élégance presque dangereuse. Bao est l’homme qui surgit “de nulle part” et qui, très vite, occupe toutes les places. Il a le charisme des vainqueurs, mais aussi une part d’opacité qui intrigue : on ne sait jamais exactement de quoi il est fait. Sa réussite est une architecture : import-export, spéculation, réseaux, intuition… et cette capacité à être au bon endroit, au bon moment, avec le bon sourire. Pourtant, la série ne tombe pas dans le mythe du self-made-man en mode poster motivational. Elle prend le temps de montrer ce que coûte une ascension : la fatigue, les dettes invisibles, les pactes qu’on signe sans en lire les petites lignes.
Et puis il y a ce que j’adore : Blossoms Shanghai sait que le cœur d’un empire, ce n’est pas seulement la bourse ou le carnet d’adresses, mais les relations. Les trois grandes figures féminines ne sont pas des satellites : elles sont des forces.
- Ling Zi (Ma Yili) a une présence au scalpel. C’est la praticienne du réel : elle connaît les prix, les humeurs, les failles des gens. Elle est drôle, dure, généreuse quand elle le décide, et son énergie donne à la série une chaleur très “quartier”, très humaine.
- Miss Wang (Tang Yan) apporte une autre couleur : la droiture, le dilemme, la tension entre désir et règle. Elle est l’élégance qui résiste.
- Li Li (Xin Zhilei), enfin, traverse l’écran comme une silhouette de parfum entêtant : pouvoir, mystère, contrôle. Elle ne “joue” pas la compétition, elle l’incarne, et chaque scène où elle entre en jeu reconfigure le paysage.

Ce qui m’a rendu franchement euphorique, c’est la façon dont la série transforme Shanghai en personnage. Pas un décor-carton, pas une carte postale nostalgique, mais une ville qui respire : restaurants où la vapeur des plats se mélange aux rumeurs, hôtels dont les ascenseurs ont l’air de monter vers des vies parallèles, rues où l’on lit la hiérarchie sociale dans la manière dont on vous salue — ou dont on feint de ne pas vous voir. Et au cœur de tout : cette fameuse rue “mythique” recréée pour le tournage, avec une minutie presque insolente. On sent l’obsession artisanale derrière chaque enseigne, chaque reflet, chaque texture. Ici, la reconstitution n’est pas un exercice d’école : c’est une machine à sensation.
La langue joue un rôle énorme dans cette immersion. Le shanghaïen n’est pas un gadget d’authenticité : c’est une musique, une appartenance, une manière d’exister. Même sans comprendre chaque nuance, on capte l’attaque, l’ironie, la tendresse, la menace. Et comme souvent chez Wong, ce ne sont pas seulement les mots qui importent : c’est ce qui flotte entre eux.
Soyons honnêtes : Blossoms Shanghai n’est pas une série “facile”. Elle demande qu’on accepte sa densité, son réseau de personnages, parfois ses détours, et une narration qui préfère l’atmosphère à l’efficacité d’un thriller. Il y a des épisodes où l’on se dit : “Ok, je suis dans une grande fresque, je dois lâcher un peu le besoin de tout maîtriser.” Mais dès que vous adoptez ce pacte, la série vous récompense : elle accumule des motifs, des échos, des détails qui reviennent vous frapper plus tard, souvent quand vous ne vous y attendez pas.
Et puis il y a ce bonheur rare : la beauté qui a du sens. Ici, le style n’est pas un filtre Instagram posé par-dessus une intrigue. La beauté raconte : elle raconte l’appétit, l’illusion, le vertige, la vitesse à laquelle une époque change de peau. Les costumes sont des armures, les lieux sont des terrains de chasse, la lumière transforme une conversation banale en duel, et un plan sur un visage suffit à révéler une fissure.
Au fond, Blossoms Shanghai ressemble à un dîner très long dans un restaurant où chaque plat arrive avec une histoire, où l’addition est salée, mais où vous sortez grisé, un peu plus vivant, et bizarrement nostalgique d’un temps que vous n’avez peut-être jamais connu. C’est une série qui ne cherche pas à plaire à tout le monde — elle cherche à vous happer. Moi, je me suis laissé faire avec un plaisir immense.
Si vous avez envie d’une expérience totale, d’un feuilleton luxueux qui parle d’argent mais surtout de désir, de réputation, de loyauté et de perte, Blossoms Shanghai est un festin. Et un festin signé Wong, ça ne se boude pas.