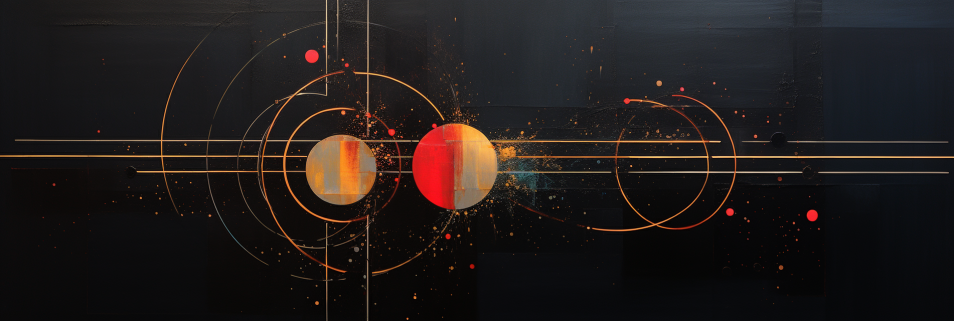Dans les ruelles animées du Caire, les marchés colorés de Khartoum ou les hauteurs d’Addis-Abeba, un phénomène spirituel et social fascine depuis des siècles : le culte du Zar. Pratiqué principalement par des femmes en Éthiopie, en Érythrée, au Soudan et en Égypte, ce rituel de possession est bien plus qu’une simple cérémonie religieuse. C’est un espace de guérison, de résistance et de solidarité, où les frontières entre le visible et l’invisible s’estompent. Le Zar, souvent mal compris ou stigmatisé, est en réalité une réponse complexe aux maux physiques, psychologiques et sociaux qui traversent les sociétés de la Corne de l’Afrique et du Nil. À travers la musique, la danse et la transe, les participantes entrent en dialogue avec des esprits tourmenteurs, transformant leur souffrance en pouvoir et leur isolement en communauté.
Des esprits errants et leurs hôtes malgré eux
Au cœur du Zar se trouve une croyance centrale : certains maux — maux de tête persistants, stérilité, dépression, ou même des comportements jugés déviants — sont causés par des esprits, les zar. Ces entités, souvent associées à des ancêtres non apaisés, à des djinns ou à des forces naturelles, sont censées « habiter » le corps d’une personne, généralement une femme, provoquant des troubles inexplicables par la médecine conventionnelle. Ces esprits ne sont pas toujours malveillants ; parfois, ils sont simplement en quête d’attention ou de reconnaissance. Leur présence se manifeste par des symptômes variés : crises de nerfs, douleurs inexpliquées, ou des rêves récurrents où une voix ou une silhouette mystérieuse se fait pressante.
Contrairement à d’autres cultes de possession où l’esprit est chassé, le Zar propose une approche radicalement différente : il s’agit de négocier avec lui. Les esprits ne sont pas des ennemis à combattre, mais des invités à apaiser. Chaque zar a sa propre personnalité, ses préférences et ses exigences. Certains aiment le café, d’autres la fumée de l’encens ou les bijoux clinquants. Leur « hôte » doit apprendre à coexister avec eux, à les contenter pour retrouver la paix. Cette vision du monde, où le corps devient un champ de bataille entre le tangible et l’invisible, offre une explication aux souffrances qui échappent à la raison, surtout dans des sociétés où les femmes ont peu d’espaces pour exprimer leur détresse.
Le rituel : une scène où se joue la libération
Le rituel du Zar est un spectacle à la fois intime et collectif. Il se déroule souvent dans une maison, en présence d’autres femmes — parfois des proches, parfois des inconnues unies par la même expérience. Une sheikha ou une kodia, une prêtresse spécialisée, dirige la cérémonie. Vêtue de robes colorées et parée de bijoux, elle incarne à la fois l’autorité spirituelle et la compassion. Autour d’elle, les tambours résonnent, les encensoirs diffusent une fumée épaisse, et les chants montent en crescendo. La musique, répétitive et hypnotique, est l’outil principal pour attirer les esprits et les amener à se révéler.
La possédée, souvent vêtue de blanc ou de couleurs vives, entre peu à peu en transe. Son corps se met à trembler, ses mouvements deviennent saccadés ou au contraire fluides, comme portés par une force extérieure. Elle peut parler d’une voix changée, adopter des gestes qui ne sont pas les siens, ou même imiter des animaux — signes que l’esprit s’exprime à travers elle. La sheikha dialogue alors avec l’entité, cherchant à comprendre ses demandes : veut-il des offrandes ? Un sacrifice animal ? Une promesse de pèlerinage ? Le but n’est pas d’expulser l’esprit, mais de conclure un pacte avec lui. En échange de son départ ou de sa bienveillance, la femme s’engage à lui rendre hommage régulièrement, à travers des rituels ou des objets symboliques.
Ce qui frappe dans ces cérémonies, c’est leur dimension théâtrale. Les femmes ne sont pas passives ; elles performen leur possession, utilisant leur corps comme un langage pour dire ce que les mots ne peuvent exprimer. La transe devient une forme de rébellion, un moyen de briser les tabous et de revendiquer une place dans une société qui les marginalise souvent.
Une thérapie par la communauté
Le Zar n’est pas seulement un exutoire individuel : c’est un système de soutien mutuel. Dans des contextes où les femmes ont peu de contrôle sur leur vie — mariages forcés, violences conjugales, pression sociale — le culte offre un espace où elles peuvent parler, pleurer, et même rire sans être jugées. Les participantes se reconnaissent les unes les autres, partageant des histoires similaires de douleurs et de résilience. La cérémonie devient une forme de thérapie collective, où la solidarité remplace la honte.
Les anthropologues soulignent que le Zar permet aux femmes de renégocier leur statut. En étant possédée, une femme peut temporairement échapper aux attentes sociales : elle n’est plus une épouse soumise ou une mère épuisée, mais une médiatrice entre les mondes, respectée pour sa connexion avec l’invisible. Certaines utilisent même le Zar pour résister à des situations intolérables — un mariage abusif, par exemple — en attribuant leur refus à la volonté d’un esprit, et non à leur propre rébellion.
Entre religion, médecine et résistance
Le Zar défie les catégories occidentales. Il n’est ni tout à fait une religion, ni une simple superstition, ni une pratique médicale. Il emprunte à l’islam — les encens, les invocations — tout en restant en marge des institutions religieuses officielles. Les clercs musulmans le condamnent souvent, le qualifiant de bid’a (innovation blâmable), mais cela n’a pas empêché son persistance, voire son essor dans les milieux urbains.
Pour les femmes qui y recourent, le Zar est avant tout une solution pragmatique. Dans des pays où l’accès aux soins psychologiques est limité, où la parole féminine est souvent étouffée, ce culte comble un vide. Il donne un nom à des maux indicibles, propose des remèdes symboliques, et restaure un sentiment de contrôle. Les offrandes et les rituels ne sont pas vus comme des dépenses futiles, mais comme des investissements dans leur bien-être.
Un héritage en mutation
Aujourd’hui, le Zar évolue. Dans les grandes villes, il se pratique parfois en secret, loin des regards désapprobateurs. Certaines sheikhas modernisent les rituels, intégrant des éléments de psychologie ou de développement personnel. D’autres, au contraire, insistent sur la dimension traditionnelle, voyant dans le Zar un patrimoine à préserver face à la mondialisation.
Pourtant, le culte reste controversé. Certains y voient une forme d’exploitation, où les prêtresses profitent de la vulnérabilité des femmes. D’autres, au contraire, saluent sa capacité à donner une voix à celles que la société ignore. Ce qui est certain, c’est que le Zar continue de répondre à un besoin profond : celui d’être entendue, reconnue, et libérée — ne serait-ce que pour quelques heures — des chaînes invisibles qui entravent les corps et les esprits.
En fin de compte, le Zar est bien plus qu’un culte de possession. C’est un miroir tendu à des sociétés en tension, où le sacré et le social s’entremêlent. Il rappelle que la souffrance, quand elle trouve un exutoire, peut se transformer en force. Et que parfois, pour guérir, il faut d’abord danser avec ses démons.