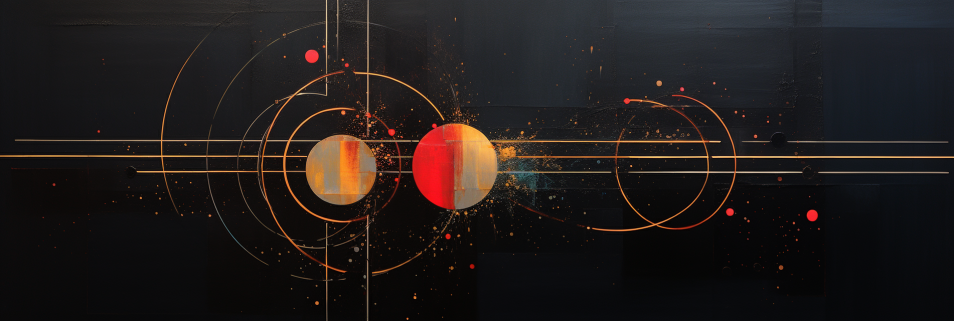La Baramine
I. 3h47
Marc s’arrache au sommeil dans un cri étouffé, les poumons en feu. À trente ans, il n’a jamais connu de réveil aussi brutal, aussi chargé d’une terreur inexplicable. Ses draps collent à sa peau, trempés d’une sueur froide qui sent la terre fraîche et quelque chose de plus âcre, de plus sombre. Dans la pénombre de sa chambre moderne aux murs blancs, les chiffres rouges du réveil digital clignotent : 3h47. Toujours la même heure.
Ses mains – des mains de comptable, fines et soignées, habituées aux calculatrices et aux dossiers clients – tremblent devant ses yeux. Sous ses ongles toujours parfaitement entretenus, une substance brunâtre qu’il n’ose identifier. Il les porte à ses narines et reconnaît cette odeur de jardin après la pluie, mêlée d’un relent métallique qui lui soulève l’estomac.
Le rêve était d’une netteté chirurgicale cette fois. Plus précis qu’un souvenir d’enfance. La baramine – ce petit outil de jardinage hérité de son père à sa mort l’hiver dernier, avec son manche en bois poli par quarante ans d’usage – s’enfonçant dans la chair tendre avec un bruit sourd, presque familier. Le visage de la victime reste flou, pixelisé comme une image corrompue, mais ses supplications résonnent encore dans ses oreilles, aussi claires que s’il les entendait vraiment.
Il se lève de son lit king-size, les jambes flageolantes, et titube vers la salle de bain attenante de leur pavillon neuf. Le miroir lui renvoie l’image d’un homme qu’il reconnaît à peine : cheveux noirs habituellement disciplinés maintenant collés au crâne, visage encore juvénile creusé par l’angoisse, regard noisette hagard cerné de violet, une égratignure sur la joue droite qu’il ne se rappelle pas s’être faite. Quand il ouvre le robinet chromé, l’eau qui coule est brunâtre les premières secondes, comme si elle charriait de la terre.
II. Le petit-déjeuner
Au petit-déjeuner dans leur cuisine design aux plans de travail en granit, Claire évite son regard avec un soin méticuleux. À vingt-huit ans, sa femme garde encore cette beauté de porcelaine qui l’avait séduit à l’université de commerce, mais ce matin ses traits sont tendus. Elle mange ses céréales bio avec une concentration exagérée, chaque cuillère mesurée, calculée, comme si elle craignait qu’un geste trop brusque ne déclenche quelque chose d’irréparable. Le silence entre eux s’épaissit, ponctué uniquement par le tic-tac obsédant de l’horloge murale design et le ronflement lointain de la chaudière.
« Tu as encore parlé cette nuit », lâche-t-elle finalement, sans lever les yeux de son bol de porcelaine japonaise.
Marc se fige, la tasse de café équitable à mi-chemin de ses lèvres. La porcelaine tremble contre ses dents blanches et régulières. « Qu’est-ce que j’ai dit ? »
« Rien de… compréhensible. Mais tu répétais un nom. Sophie, je crois. Tu semblais… en colère. »
Sophie. Ce prénom lui vrille le cerveau comme une mèche rouillée. Il fouille sa mémoire organisée de comptable, retourne chaque recoin de sa conscience méthodique, mais ne trouve rien. Il ne connaît aucune Sophie dans son entourage professionnel ou personnel. Du moins, il ne croit pas.
Au bureau de leur cabinet comptable – “Dubois & Mathieu, Expertise comptable” selon la plaque dorée de l’entrée –, l’atmosphère s’est tendue d’un voile invisible. Ses collègues et clients semblent le regarder différemment, avec une prudence nouvelle qui lui donne la chair de poule. Mathieu, son associé depuis leurs études supérieures de commerce il y a huit ans, interrompt brusquement sa conversation téléphonique quand Marc passe devant son bureau vitré. Madame Berger, leur secrétaire sexagénaire habituellement chaleureuse, sursaute quand il la salue, renversant son café sur ses dossiers impeccablement classés.
« Désolée, monsieur Marc, je… je ne vous avais pas entendu arriver », balbutie-t-elle en épongeant frénétiquement les taches brunes qui s’épanouissent sur le papier blanc comme des fleurs de sang.
III. Le cabinet
Le cabinet du Dr Reyes, situé dans un immeuble haussmannien du centre-ville, sent l’encaustique et l’anxiété mal digérée. Marc, dans son costume anthracite de jeune cadre dynamique, s’enfonce dans le fauteuil en cuir craquelé, ses paumes moites laissant des traces d’humidité sur les accoudoirs. Le psychiatre, un homme sec aux tempes grisonnantes qui doit avoir l’âge qu’aurait eu son père, griffonne dans son carnet sans relever la tête.
« Ces rêves… ils deviennent plus fréquents ? », demande-t-il de sa voix neutre, clinique, qui rappelle à Marc les derniers mois de son père à l’hôpital.
« Plus précis surtout. Je sens même l’odeur du sang, la texture de… de l’outil. C’est comme si mes sens étaient plus aiguisés dans le rêve que dans la réalité. »
Dr Reyes relève enfin la tête, ses lunettes demi-lune reflétant la lumière, son stylo Mont-Blanc suspendu dans l’air comme une épée de Damoclès. « Quel outil ? »
« Une baramine. Un outil de jardin, vous savez, pour arracher les mauvaises herbes. Mon père m’en avait montré l’usage quand j’étais enfant, dans le jardin de ma grand-mère. Il disait que c’était l’outil parfait pour les racines tenaces. »
Un silence pesant s’installe, troublé seulement par le grattement frénétique du stylo sur le papier. Le psychiatre note quelque chose – beaucoup trop long pour être anodin, beaucoup trop détaillé pour une simple remarque. Marc observe ses gestes, habitué par son métier à décrypter les attitudes des clients qui cachent quelque chose.
« Marc, votre père est décédé récemment, n’est-ce pas ? »
« L’hiver dernier. Cancer du poumon. Mais je ne vois pas le rapport… »
« Les traumatismes refoulés peuvent resurgir sous forme onirique, surtout après un deuil. Parfois, la frontière entre souvenir et fantasme devient… poreuse. »
Le mot « fantasme » résonne dans le cabinet comme une accusation. Marc quitte les lieux avec une ordonnance pour des anxiolytiques et l’impression troublante que Dr Reyes en sait plus qu’il ne veut bien dire.
IV. Sophie
À la boulangerie artisanale du quartier – une des rares commerces que Marc fréquente à pied depuis leur pavillon –, Madame Fournier lui tend sa baguette tradition habituelle avec un sourire crispé qui ne monte pas jusqu’à ses yeux. Ses gestes sont mécaniques, automatiques, comme si elle répétait une chorégraphie apprise par cœur.
« Alors, monsieur Marc, on dort bien ces temps-ci ? »
La question, apparemment anodine, le glace jusqu’aux os. Marc ajuste machinalement sa cravate, geste nerveux qu’il a développé depuis la mort de son père. « Pourquoi cette question ? »
« Oh, pour rien… C’est juste que ma fille Sophie habite dans votre quartier maintenant. Rue des Tilleuls, dans le petit studio au-dessus de la pharmacie. Elle m’a dit avoir entendu des cris la nuit dernière. »
Sophie. Ce prénom encore, qui résonne comme un glas dans sa tête méthodique de comptable. Marc sent ses jambes se dérober sous lui, son costume soudain trop serré.
« Votre fille… elle va bien ? »
Madame Fournier le dévisage avec une intensité troublante, ses petits yeux noirs plantés dans les siens comme des aiguilles. « Pour l’instant, oui. Pour l’instant. Elle travaille de nuit, vous savez, à l’hôpital. Aide-soignante. Elle rentre souvent tard. »
En rentrant chez lui par les rues pavillonnaires aux réverbères LED du quartier résidentiel, Marc découvre que son voisin, Monsieur Patel, retraité de la poste habituellement discret, a installé une caméra de surveillance flambant neuve. L’objectif semble pointé directement sur sa maison, sur sa fenêtre de chambre plus précisément. Quand leurs regards se croisent par-dessus la haie de troènes parfaitement taillée, le vieil homme détourne immédiatement les yeux vers son journal du soir.
V. La terre sous les ongles
Cette nuit-là, le rêve atteint une netteté photographique qui dépasse tout ce qu’il a connu dans ses trente années d’existence. Il se voit dans le jardin communal municipal, près du vieil abri de jardinage où les habitants du quartier stockent leurs outils. La lune découpe des ombres nettes sur le gravier ratissé, transformant chaque buisson en créature tapie.
Sophie – car c’est bien elle maintenant, visage enfin défini, jeune femme d’une vingtaine d’années aux cheveux châtains ondulés, regard terrorisé qui le supplie dans une langue qu’il comprend sans l’entendre – gît devant lui dans une mare écarlate. Sa blouse blanche d’aide-soignante s’est muée en linceul pourpre. La baramine de son père dépasse de sa poitrine comme un épouvantail grotesque, son manche en bois sombre luisant sous la clarté lunaire.
Il entend sa propre voix, rauque, méconnaissable, déformée par une rage qu’il ne se connaissait pas, répéter comme une litanie : « Tu n’aurais pas dû me suivre, tu n’aurais pas dû fouiller… »
Au réveil brutal dans leur chambre aux rideaux tirés, Marc découvre de la terre sous ses ongles de comptable toujours soignés. De la vraie terre, avec des brindilles de gazon et de petits graviers qui s’incrustent dans sa peau. Il n’a pourtant pas jardiné depuis des mois, depuis qu’il a hérité des outils de son père et les a rangés dans leur garage automatique.
Sa baramine, habituellement rangée dans le garage entre la tondeuse électrique neuve et les sacs d’engrais bio de Claire, a disparu.
VI. Traces
Les frontières entre rêve et réalité s’effritent comme du papier mouillé sous la méticulosité habituelle de Marc. Il trouve des cheveux châtains sur sa veste de costume – il est pourtant brun et Claire blonde comme les blés d’été. Une odeur de terre fraîche imprègne sa BMW série 3 flambant neuve, malgré les fenêtres hermétiquement fermées et l’habitacle désodorisé la veille au garage.
Dans la boîte aux lettres design de leur portail automatique, coincée entre les factures EDF et la publicité du supermarché bio, une carte postale sans expéditeur : une photo du jardin communal prise de nuit, les ombres dansant entre les allées éclairées par les lampadaires municipaux. Au dos, d’une écriture féminine appliquée qu’il ne reconnaît pas, un simple mot : « Sophie ».
Au Monoprix du centre commercial, près du rayon légumes bio que fréquente Claire, il croise une jeune femme aux cheveux châtains qui trie des tomates cerises avec soin. Elle porte une blouse blanche sous sa veste jean, probablement en pause de son service à l’hôpital. Leurs regards se croisent par hasard et elle pâlit instantanément, lâche ses courses qui roulent sur le carrelage, s’enfuit en courant vers la sortie automatique. Marc la suit de son pas de jeune cadre habitué au jogging matinal, mais elle disparaît dans la foule du parking comme un mirage.
Ce soir-là, Claire ne rentre pas dans leur pavillon silencieux. Elle laisse un message laconique sur le répondeur de leur téléphone fixe, sa voix étrangement distante : « Je dors chez ma sœur à Tours. Nous devons parler. »
VII. Le déjeuner
Mathieu l’invite à déjeuner dans un restaurant bruyant du centre-ville – choix étrange pour son associé qui préfère habituellement le calme feutré de leur bureau pour leurs réunions d’affaires trimestrielles. Le bruit des conversations et le cliquetis des couverts créent un fond sonore oppressant qui résonne dans le crâne de Marc.
« Marc, tu te souviens de jeudi dernier ? Tu devais passer chez moi vers 20h pour les dossiers Dubois-Mercier. »
Marc fouille sa mémoire organisée comme on cherche dans un tiroir malmené. Mathieu habite dans un appartement moderne près de la gare, ils ont l’habitude de ces réunions de travail tardives. Jeudi… un trou noir béant après 18h, comme si quelqu’un avait effacé une portion de sa vie bien ordonnée.
« J’ai eu un empêchement, je crois. Un problème familial. »
« Ouais… c’est ce que j’ai pensé quand je t’ai vu au jardin communal vers 22h. Tu avais l’air… occupé. »
Le restaurant climatisé se met à tourner autour de Marc, les visages des autres clients deviennent flous. « Tu m’as vu ? »
« De loin, depuis ma voiture. Avec une jeune femme en blouse blanche. Elle semblait contrariée, agitée. Vous parliez de façon animée près de l’abri de jardinage. »
Mathieu, son ami depuis leurs vingt ans, plante ses yeux gris dans ceux de Marc, cherchant quelque chose – un aveu, un déni, un signe de culpabilité ou d’innocence dans le regard de cet homme qu’il croyait connaître.
« Je ne me rappelle pas », murmure Marc, la bouche sèche, ajustant sa cravate d’un geste nerveux.
« La mémoire, c’est fragile », conclut Mathieu en payant l’addition d’un geste sec de sa carte bleue. « Surtout quand on préfère oublier. »
VIII. Dans le coffre
En rentrant chez lui par les rues désertes de l’après-midi, Marc découvre sa baramine dans le coffre de sa BMW. Elle est propre, trop propre, comme récemment nettoyée avec un soin maniaque digne de sa personnalité obsessionnelle. Mais dans les rainures du métal, des traces brunâtres subsistent, incrustées dans les aspérités que le nettoyage le plus méticuleux n’a pu atteindre.
Dans la poche de sa veste de jeudi – celle en laine anthracite qu’il réserve aux rendez-vous clients importants –, il trouve un morceau de tissu blanc taché de rouge. Le tissu est doux, technique, comme celui d’une blouse médicale. Il ne porte jamais de blanc, trop salissant pour un comptable.
Sur son iPhone dernière génération, dans l’historique des messages qu’il consulte rarement, un SMS envoyé jeudi à 21h47 à un numéro qu’il ne reconnaît pas : « RDV habituel, jardin communal. Viens seule. »
Il n’a aucun souvenir d’avoir composé ce message de ses doigts habitués aux calculatrices, aucun souvenir de ce numéro qui commence par 06.
La réponse, arrivée quelques minutes plus tard de ce même numéro inconnu : « J’arrive. Sophie. »
Marc, le jeune comptable méthodique qui n’a jamais eu de problème de digestion, vomit dans l’évier design de leur cuisine, ses jambes en costume ne le portant plus.
IX. Les regards
Au commissariat municipal – quand y est-il allé ? il ne s’en souvient pas, lui qui note pourtant tous ses rendez-vous dans son agenda électronique –, l’inspecteur Moreau lui serre la main un peu trop longuement, ses doigts épais et moites s’attardant sur ceux du jeune homme.
« Nous nous reverrons bientôt, monsieur Dubois. Très bientôt. Les comptes, ça peut être compliqué à tenir, pas vrai ? »
À la pharmacie moderne de leur quartier, en achetant ses anxiolytiques prescrits par Dr Reyes, le pharmacien trentenaire glisse discrètement un autre médicament dans le sac en papier kraft : « C’est de la part du Dr Reyes. Il a dit que vous comprendriez. »
C’est un somnifère puissant, le genre qu’on administre en milieu hospitalier selon l’étiquette. La mention manuscrite porte : « En cas de crise aiguë seulement. »
Sa sœur Émilie l’appelle depuis Marseille sur son portable, prétexte un voyage impromptu qu’elle n’avait jamais mentionné lors de leur dernier déjeuner dominical. « Je pars quelques semaines à l’étranger pour le boulot, ne cherche pas à me contacter. »
Claire ne répond plus au téléphone, ses appels de jeune mari inquiet tombent directement sur la messagerie de son épouse.
Même Rex, le golden retriever des voisins habituellement affectueux qui venait quémander des caresses à travers la grille automatique, grogne maintenant quand Marc passe devant le portail en rentrant du bureau, les crocs découverts.
X. La perspective
Cette nuit, le rêve change de perspective avec la fluidité d’un travelling cinématographique. Marc se voit de l’extérieur, comme s’il regardait un film de sa propre vie. Il s’observe, allongé à côté du corps de Sophie dans l’abri de jardinage sombre et humide. Ses vêtements de jeune cadre sont maculés de sang coagulé, ses yeux noisette ouverts mais vides, vitreux, comme s’il était en transe ou sous l’emprise d’une substance.
Autour de lui, des silhouettes familières émergent de l’ombre : Claire en manteau noir qu’il ne lui connaît pas, Mathieu tenant une lampe torche LED, Dr Reyes avec sa mallette de cuir vintage, l’inspecteur Moreau qui prend des photos avec un appareil professionnel. Ils discutent à voix basse, évoquent « la procédure », « l’internement », « la nécessaire solution » avec des termes qu’il ne comprend qu’à moitié.
L’un d’eux – impossible de distinguer lequel dans la pénombre mouvante – murmure : « Il fallait qu’il découvre le corps lui-même. C’est la seule façon de boucler le dossier proprement. »
Marc-rêveur, le comptable de trente ans méticuleux, essaie de bouger, de crier, mais son corps jeune et sportif refuse d’obéir, paralysé par une force invisible. Il entend sa propre voix, lointaine et déformée : « Qu’est-ce que vous m’avez fait ? Pourquoi ? »
XI. L’abri
Marc s’arrache brutalement au sommeil, mais quelque chose cloche immédiatement dans son esprit habitué à l’ordre. Ce n’est pas son lit king-size douillet, pas sa chambre moderne aux murs blancs familiers. Le sol est froid, en béton brut qui glace ses membres de trentenaire habitué au confort, et l’air sent la moisissure et la mort. L’odeur de terre humide et de sang séché l’assaille, contracte l’estomac de ce jeune homme qui n’a jamais connu la violence.
À côté de lui, exactement comme dans le rêve prophétique, gît le corps de Sophie. Ses cheveux châtains s’étalent en éventail sur le sol crasseux, ses yeux vitreux fixent les poutres rongées du plafond de l’abri de jardinage municipal. La baramine de son père dépasse de sa poitrine comme un mât sanglant, son manche familier maintenant souillé d’une substance que Marc refuse de reconnaître.
Marc se redresse en titubant, sa silhouette de jeune cadre élancé vacillant dans la pénombre. Ses mains soignées de comptable sont couvertes de sang séché qui craque quand il bouge ses doigts aux ongles habituellement manucurés. Ses vêtements, ceux qu’il portait jeudi selon ses souvenirs fragmentaires, sont tachés et déchirés comme s’il avait livré bataille.
Il n’a aucun souvenir de s’être rendu ici, aucun souvenir de… de cela.
« Marc ? »
Claire se tient dans l’embrasure de la porte vermoulue, accompagnée de l’inspecteur Moreau et du Dr Reyes. Leurs visages expriment un mélange calculé de tristesse et de résignation, comme s’ils jouaient une pièce de théâtre répétée cent fois pour un public d’un seul spectateur.
« C’est fini », murmure Claire d’une voix qu’il ne reconnaît pas chez sa jeune épouse. « Tu peux arrêter de lutter maintenant. »
XII. Les mains propres
« Nous savions que tu finirais par nous amener ici », dit Dr Reyes en s’approchant lentement, ses chaussures de cuir crissant sur le gravier de l’abri. « Les somnifères que nous t’avons administrés progressivement dans tes anxiolytiques te rendaient somnambule. Nous avons simplement… guidé tes pas de jeune homme fragile. »
Marc recule, le dos contre le mur humide de l’abri, sa stature de trentenaire soudain réduite à celle d’un enfant. « Guidé ? Vous m’avez fait tuer Sophie ? »
« Sophie ? » L’inspecteur Moreau fronce les sourcils, consultant ses notes d’un air perplexe. « Marc, regarde bien. Regarde avec tes yeux de comptable habitué aux détails. »
Marc baisse les yeux vers le corps étendu sur le béton froid. Le visage de la victime change, se trouble, se recompose comme une image qui se pixelise et se reforme sous son regard de myope léger. Ce n’est plus Sophie aux cheveux châtains ondulés. C’est son propre visage de trentenaire qui le fixe depuis le sol, bouche ouverte dans un cri silencieux, ses propres yeux noisette morts qui l’accusent.
« Tu es en pleine crise dissociative depuis trois semaines », explique Dr Reyes d’une voix clinique qui résonne dans l’abri comme un diagnostic. « Nous essayons de te ramener à la réalité par la thérapie de choc. »
Mais quand Marc lève les yeux, l’abri de jardinage s’est volatilisé comme un décor de théâtre. Il se trouve dans une chambre blanche immaculée, sanglé sur un lit d’hôpital aux draps trop serrés pour ses membres de jeune homme. Dr Reyes tient une seringue remplie d’un liquide ambré.
« Encore un épisode », murmure-t-il à l’infirmière en blouse immaculée. « Augmentez la dose pour ce patient de trente ans. »
La piqûre brûle dans ses veines de comptable habitué aux petits maux…
Ou peut-être…
Marc cligne des yeux, la vision se trouble dans son esprit de trentenaire méthodique. Il est dans son salon familier aux meubles design, affalé dans son fauteuil en cuir italien préféré. Claire le secoue doucement, ses mains chaudes et rassurantes sur les épaules de son jeune mari.
« Tu as encore fait un cauchemar, chéri. Un très long cauchemar. Tu travailles trop, ces dossiers te stressent. »
Sur la table basse en verre design, un journal local est ouvert à la page des faits divers : « Jeune femme disparue : Sophie Martineau, 23 ans, aide-soignante, vue pour la dernière fois jeudi soir près du jardin communal. La police lance un appel à témoins. »
La photo de Sophie sourit à Marc depuis le papier journal, ses cheveux châtains brillant sous les projecteurs du photographe.
Marc regarde ses mains de comptable posées sur ses genoux. Elles sont propres, d’une propreté parfaite, manucurées comme celles d’un jeune cadre soucieux de son apparence.
Trop propres.
Dans le jardin de leur pavillon, par la fenêtre ouverte sur la nuit, il entend le bruit familier du métal qui creuse la terre. Quelqu’un jardine à cette heure tardive, avec application, méthode.
Avec une baramine.
Texte issu des légendes de Calahaan